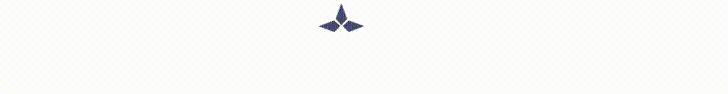La perspective d’une année blanche s’impose désormais comme un scénario crédible dans le débat public gabonais. Alors que la grève des enseignants se prolonge depuis plusieurs semaines, l’hypothèse a été évoquée au plus haut niveau de l’État. Selon des témoignages concordants issus de la rencontre tenue à la Présidence avec des représentants de SOS Éducation, le président Brice Clotaire Oligui Nguema aurait indiqué qu’une année blanche « ne le dérangerait pas », évoquant même la possibilité de réallouer les ressources prévues aux salaires vers la construction d’infrastructures scolaires. Une déclaration qui a contribué à durcir le climat social dans le secteur éducatif.
Cette sortie intervenait dans un contexte déjà extrêmement tendu. Depuis le début du mois de janvier, les enseignants réclament la régularisation de près de 10 000 situations administratives, dont environ 6 574 dossiers formellement déposés auprès de la Fonction publique. Le gouvernement, de son côté, met en avant des mesures concrètes : 4 000 dossiers traités, 1 810 ex-bénévoles intégrés, 692 enseignants placés en présalaire, 328 sortants ENS/ENSET mis en solde et 108 enseignants des filières scientifiques régularisés. Ces chiffres, régulièrement relayés par la communication officielle, n’ont toutefois pas suffi à convaincre la base enseignante, qui juge les avancées partielles et insuffisamment sécurisées.
Le débat sur l’année blanche est également nourri par des éléments techniques. Selon les standards rappelés par l’UNESCO, une année scolaire normale doit couvrir 30 à 32 semaines effectives de cours. En dessous de 26 à 29 semaines, l’année est considérée « à risque », avec un danger de non-reconnaissance des diplômes à l’international. En deçà de 25 semaines, l’année est réputée « blanche » comme l’a récemment rappelé Geoffrey Foumboula Libeka, membre du CESE. Or, à la date actuelle, plusieurs établissements du Grand Libreville n’ont assuré que moins des deux tiers du volume horaire théorique, du fait des arrêts répétés des enseignements depuis le début de l’année scolaire.
Face à cette situation, les autorités mettent en avant la nécessité de « protéger l’avenir des enfants » et de préserver la continuité du service public. L’argument est central dans la communication gouvernementale : l’école ne peut devenir un instrument de blocage durable. C’est dans ce cadre que sont invoqués les audits du fichier matricule et des vacations, présentés comme indispensables pour fiabiliser la dépense publique, alors que la masse salariale de l’éducation nationale dépasse 205 milliards FCFA pour environ 25 700 agents, selon les données de la loi de finances 2026.
Du côté des enseignants, les attentes restent clairement formulées. La base syndicale réclame des actes administratifs signés, un calendrier précis et opposable, ainsi que des garanties écrites sur les rappels de solde et les intégrations restantes. La crainte exprimée est celle d’un règlement incomplet, laissant subsister des milliers de situations non traitées, tandis que la menace d’une année blanche pèserait avant tout sur les élèves et leurs familles, accentuant une éducation déjà marquée par de fortes inégalités entre public et privé.
Ainsi, l’année blanche, longtemps considérée comme un scénario extrême, s’est progressivement installée au cœur du débat national. Entre un gouvernement qui affiche des avancées chiffrées mais conditionnées à des audits, et des enseignants qui estiment que l’essentiel de leurs revendications demeure sans réponse définitive, l’école gabonaise se retrouve au centre d’un arbitrage lourd de conséquences. Au-delà du bras de fer social, c’est désormais la validité même de l’année scolaire et l’avenir immédiat de plusieurs centaines de milliers d’élèves qui se trouvent en suspens.