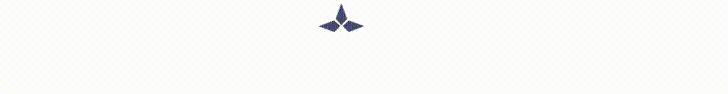Le communiqué signé par le Secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, en date du 18 janvier 2026, marque un changement de posture de l’exécutif. Après plusieurs semaines de négociations, de commissions techniques et d’annonces partielles, le gouvernement ne cherche plus à convaincre : il ordonne. En actant unilatéralement la reprise des cours à compter du lundi 19 janvier, l’État fait le choix assumé du rapport de force institutionnel face à une contestation enseignante qui, sur le terrain, demeure largement mobilisée.
Sur le fond, le document ne contient aucune mesure nouvelle. Il se borne à invoquer de supposées « avancées significatives du dialogue », sans préciser ni leur contenu, ni leur calendrier d’exécution, ni les mécanismes de suivi. Or, c’est précisément l’écart entre annonces et mises en œuvre effectives qui alimente la défiance du corps enseignant depuis des années. En l’absence d’actes administratifs opposables (arrêtés, mises en solde effectives, rappels payés), l’injonction ministérielle apparaît davantage comme une tentative de reprise en main que comme l’aboutissement d’un compromis.
Le ton du communiqué est révélateur. L’appel à la « responsabilité », au « civisme » et à la « sauvegarde de l’année scolaire » transfère implicitement la charge de la crise sur les enseignants eux-mêmes. Cette rhétorique, déjà utilisée lors de précédents conflits sociaux, ignore volontairement le cœur des revendications : régularisation des carrières, paiement des rappels de solde et sécurisation des parcours professionnels. En clair, l’État exige la reprise du service public sans solder le passif administratif qui a précisément provoqué la grève.
En optant pour cette stratégie, le gouvernement prend un risque politique. Le bras de fer peut fonctionner face à des mouvements fragmentés ou essoufflés mais il devient contre-productif lorsque la base est structurée, radicalisée et convaincue que les annonces ne produiront aucun effet durable.
L’histoire récente du secteur éducatif gabonais montre que les injonctions hiérarchiques n’ont jamais suffi à régler des crises enracinées dans des décennies de dysfonctionnements. Ce choix du rapport de force marque donc une rupture : soit l’État assume une confrontation prolongée avec un coût social et éducatif élevé, soit il sera contraint, sous la pression des faits, de revenir à la table des négociations avec des engagements plus lourds financièrement. Dans les deux cas, la séquence actuelle confirme que la crise éducative ne relève plus de la simple gestion sectorielle, mais d’un test de crédibilité de la gouvernance publique.