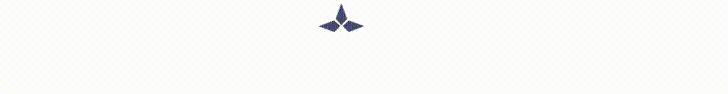Le mouvement de grève des enseignants précarisés, entré dans son deuxième jour ce mardi 6 janvier, met une nouvelle fois à nu les fragilités structurelles du système éducatif gabonais. À travers les témoignages venus du Grand Libreville comme de l’intérieur du pays, un même schéma se répète : pressions hiérarchiques, intimidations, menaces à peine voilées, et tentatives de contournement du mot d’ordre de grève par l’imposition d’un prétendu « service minimum ». Autant de pratiques qui traduisent moins une volonté de dialogue qu’une gestion autoritaire d’une crise sociale pourtant reconnue comme légitime par la tutelle elle-même.
Dans plusieurs établissements, des chefs d’établissement auraient usé de leur autorité pour interdire purement et simplement l’exercice du droit de grève, tandis que d’autres auraient tenté une approche plus insidieuse, jouant sur le chantage moral autour des classes d’examen. Ces méthodes ne sont pas nouvelles. Elles rappellent les précédents mouvements sociaux dans l’éducation, où la pression administrative finissait par user la mobilisation. La différence aujourd’hui réside dans le refus assumé de céder, porté par une base enseignante déterminée à rompre avec ce cycle de concessions sans résultats durables.
Au cœur de la revendication, il n’est pas question de vacations ponctuelles ni d’arrangements provisoires. Les enseignants précarisés insistent sur un point central : la régularisation de leurs situations administratives, seule garantie d’une carrière sécurisée et d’une retraite décente. Les vacations, bien que dues, sont perçues comme un palliatif budgétaire incapable de régler le fond du problème. Ce discours tranche avec les réponses habituelles de l’administration, souvent focalisées sur l’urgence du calendrier scolaire plutôt que sur la soutenabilité du corps enseignant.
Le ton du message diffusé par les grévistes marque également une rupture. Il dénonce ouvertement les logiques de préservation des postes et des privilèges, accusant certains relais administratifs de sacrifier l’intérêt collectif au profit d’avantages individuels. Cette radicalité verbale traduit un épuisement profond face à un système qui, depuis des années, empile les réformes annoncées sans résoudre la question centrale de la précarité enseignante, pourtant documentée dans de nombreux conseils des ministres et plans sectoriels.
Dès lors, quelle crédibilité pour les réformes éducatives annoncées par l’État, si ceux qui font vivre l’école restent enfermés dans l’insécurité administrative ? En affirmant que « cette fois-ci, c’est tout ou rien », les enseignants ne défendent pas seulement des intérêts corporatistes, mais interpellent l’État sur sa capacité à bâtir un système éducatif viable. À défaut d’une réponse structurelle, la crise actuelle pourrait bien devenir un nouveau marqueur de l’écart persistant entre les discours de réforme et la réalité du terrain scolaire gabonais.