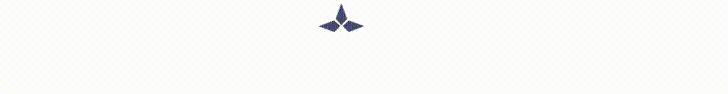Depuis le début des années 1990, le mouvement enseignant gabonais s’est structuré autour de syndicats puissants, capables de mobiliser massivement et d’imposer des négociations à l’État. À l’époque, les plateformes revendicatives sont claires : statuts, salaires, avancements, conditions de travail. Les premières grandes grèves arrachent des protocoles d’accord écrits, souvent signés en présence de ministres, parfois même du Premier ministre. Mais très tôt, un mal s’installe : l’accord devient un outil d’apaisement, non d’exécution. On signe pour reprendre les cours, puis l’administration temporise, fractionne, oublie.
Au fil des années 2000, le rapport de force s’inverse subtilement. Les syndicats historiques, longtemps perçus comme les gardiens de la mémoire des luttes, notamment après 1992, entrent dans une zone de dépendance vis-à-vis de l’État. Certains responsables syndicaux sont appelés à des fonctions administratives, d’autres deviennent conseillers, directeurs, inspecteurs. Officiellement, il s’agit de “valoriser l’expertise”. Officieusement, la base y voit une neutralisation progressive de la contestation. À chaque cycle de grève, la même suspicion ressurgit : qui négocie ? pour qui ? et contre quoi ?
Cette mécanique produit ce que les enseignants appellent désormais des “accords fantômes”. Des textes signés, parfois paraphés, rarement publiés, encore plus rarement exécutés. La régularisation administrative est promise “par vagues”, les rappels de solde “après audit”, les intégrations “au prochain collectif budgétaire”. Résultat : des milliers de dossiers s’accumulent, certains pendant dix ou quinze ans. Dans le même temps, la base constate que les syndicats signataires changent de discours, appellent à la reprise des cours, puis disparaissent des radars lorsque l’exécution tarde. La grève cesse d’être un levier stratégique ; elle devient un rituel épuisant.
La conséquence est extrêmement lourde : la confiance se brise. Les enseignants précarisés, contractuels, vacataires, agents sans actes, se sentent trahis par des structures qu’ils estiment désormais plus soucieuses de préserver leurs canaux avec le pouvoir que de défendre la base. Cette fracture interne explique la radicalité du discours actuel : refus des négociations en petit comité, rejet des listes nominatives transmises à l’administration, exigence de débats publics et de décisions votées collectivement. Ce n’est pas un caprice : c’est une réaction à trente ans de dialogue social vidé de sa substance.
C’est dans ce contexte qu’émerge SOS Éducation. Le collectif se construit explicitement contre la logique de cooptation. Pas de leaders permanents, pas de négociation discrète, pas d’accord sans publication. Chaque décision doit être validée par la base, chaque rencontre rendue publique. Là où les syndicats traditionnels ont accepté la temporalité de l’État, lente et dilatoire, SOS Éducation impose une temporalité sociale : tant que les actes administratifs ne sont pas signés et exécutés, le mouvement continue.
Cette rupture organisationnelle explique la dureté inédite de la grève actuelle. Elle ne vise plus seulement des primes ou des rappels ponctuels, mais le cœur du système : la fabrication institutionnelle de la précarité. En refusant de se laisser “absorber” par l’appareil administratif, SOS Éducation remet sur la table une question que les syndicats historiques avaient fini par contourner : à quoi sert un dialogue social si l’État ne respecte pas sa propre signature ? La paralysie de 2026 n’est donc pas seulement un conflit salarial ; elle est le résultat d’un dialogue social désarmé par la cooptation, puis réinventé dans la confrontation.