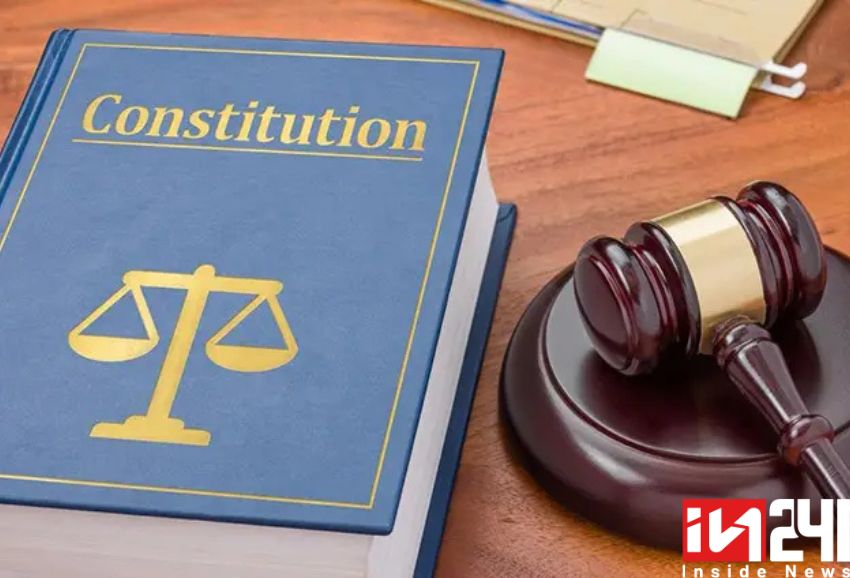La concentration des pouvoirs au Gabon, où le président détiendra à la fois les fonctions exécutives et gouvernementales que propose le projet de nouvelle constitution, pose un risque considérable de corruption et de gouvernance en déphasage avec les recommandations des partenaires techniques et financiers. Dans un système où les mécanismes de contrôle et d’équilibre sont affaiblis, les abus de pouvoir deviennent plus probables. On a pu le voir sous le régime déchu. Des pays comme le Botswana, qui ont mis en place des institutions solides et un cadre législatif favorisant la transparence, montrent comment une séparation des pouvoirs peut réduire significativement le risque de corruption. Résultat, le Botswana, avec un taux de corruption parmi les plus bas en Afrique, illustre l’importance de la responsabilité institutionnelle dans la lutte contre les abus.
Au Gabon, la situation est totalement différente. La concentration des pouvoirs que suggère cette nouvelle monture de Constitution, rend difficile la mise en place de systèmes de vérification et de responsabilité. Lorsque le président exerce un contrôle quasi absolu sur le gouvernement, il n’existe que peu d’incitations à la transparence ou à la reddition de comptes. Il n’y aura jamais de Premier ministre venant de l’opposition en cas de majorité au parlement à travers les élections législatives. Donc aucune cohabitation n’est possible puisque le président de la République, en tant que Chef du gouvernement, conduira sa propre politique. Bien que respectant les principes de séparation des pouvoirs, le régime présidentiel est caractérisé par la non-responsabilité de l’exécutif devant le législatif. Le président ne passera jamais devant l’Assemblée nationale pour défendre une feuille de route.
Risque de corruption
Aussi, le président de la République qui est censé avoir un rôle d’arbitre sera désormais celui qui déterminera et conduira la politique de la Nation. Il sera ainsi chef des armées, présidera les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale, et sera en même temps responsable de la défense nationale, tout en disposant de la force armée. A moins qu’il s’agisse d’un régime présidentiel à la gabonaise. Ce qui serait surprenant.
Les expériences passées montrent d’ailleurs que, dans un contexte de pouvoir concentré, les ressources publiques peuvent être détournées à des fins personnelles, entraînant un gaspillage des fonds et une détérioration des services publics. Toute chose ayant des conséquences directes sur le développement économique et social du pays.
Le risque de corruption est dans le même temps exacerbé par la durée du mandat présidentiel de sept ans également proposé dans la nouvelle Constitution. Or, de nombreuses démocraties, des mandats plus courts favorisent un climat de responsabilité, où les dirigeants sont tenus de rendre des comptes régulièrement. En comparaison, le Gabon, avec sa structure actuelle, permet aux dirigeants de rester en place pendant de longues périodes, renforçant ainsi le risque d’abus et de favoritisme. À l’inverse, des pays comme le Sénégal ont institué des limites de mandat (5 ans) qui favorisent une alternance politique, réduisant ainsi le risque de corruption et de stagnation économique.
En outre, la perception de la corruption peut avoir des répercussions économiques significatives. Les investisseurs étrangers sont souvent réticents à s’engager dans des environnements où la corruption est endémique. Le Botswana, en revanche, attire des investissements en raison de son cadre transparent et de sa gouvernance efficace. Le Gabon, s’il ne parvient pas à établir des mécanismes de contrôle robustes, risque de voir ses opportunités économiques diminuer, limitant ainsi son potentiel de développement.
Les États-Unis, un modèle à part
Par ailleurs, le modèle du régime présidentiel des États-Unis n’est pas applicable à un pays comme le Gabon. Les États-Unis est un pays composé de plusieurs États dits fédéraux dirigés par des gouverneurs élus et pas nommés par le président. Pour la petite histoire, les pays d’Amérique latine qui ont adopté le régime présidentiel ont fini dans une instabilité politique sans précédent, avec des coups d’Etat ou révolutions comme seule réponse aux changements de pouvoirs. Selon le constitutionnaliste Boris Mirkine-Guetzévitch, le régime présidentiel est la raison fondamentale des dictatures dans les pays qui ont voulu imiter les États-Unis. « Nous considérons le régime présidentiel, ou plutôt la transformation inévitable de ce régime en dictature comme une des causes principales de l’épidémie dictatoriale qui sévit en Amérique latine », déclarait-il en 1963.
Nécessité d’une réelle séparation des pouvoirs
Dès lors, le projet de constitution gabonais, qui prône une séparation des pouvoirs exécutif, parlementaire et judiciaire, soulève des interrogations quant à sa mise en œuvre effective. Alors que le texte constitutionnel évoque des principes démocratiques, la réalité de la concentration des pouvoirs semble contredire ces idéaux. L’exemple du Sénégal, où des institutions solides garantissent l’application des lois et la lutte contre la corruption, montre qu’une séparation véritable des pouvoirs est essentielle pour ancrer la démocratie et favoriser la responsabilité.
La centralisation du pouvoir pourrait réduire les possibilités d’engagement citoyen, nuisant ainsi aux efforts de lutte contre la corruption. Pour instaurer un climat de confiance et de transparence, le Gabon doit envisager une refonte de son modèle de gouvernance, visant à favoriser la responsabilité, la participation citoyenne et la séparation des pouvoirs.