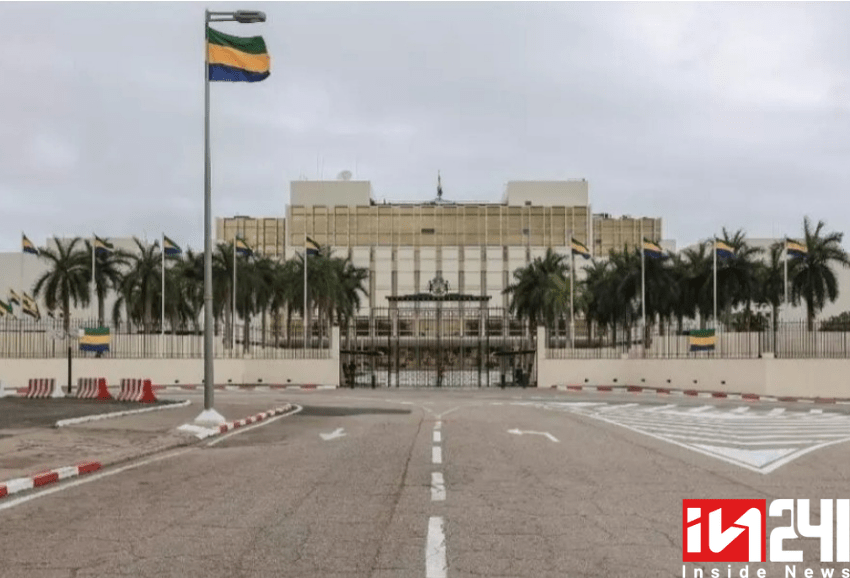Depuis le coup d’État du 30 août 2023, la transition menée par Brice Clotaire Oligui Nguema s’est accompagnée d’un niveau de dépenses politiques inédit au Gabon. En 18 mois, 112 milliards de fcfa ont été alloués à des initiatives strictement politiques, soit l’équivalent du budget annuel du ministère des Transports (112,4 milliards en 2025) et près de 10% des recettes fiscales attendues pour l’exercice budgétaire en cours. Ce montant englobe les 27 milliards mobilisés pour le référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, les 6 milliards pour le dialogue national inclusif d’avril 2024, et les 78,9 milliards inscrits dans la loi de finances 2025 sous la rubrique des dépenses politiques. Une somme considérable, qui interroge sur les choix budgétaires de la transition, alors que des secteurs vitaux comme la santé ou l’éducation peinent à suivre la même dynamique.
Cette explosion des dépenses politiques est d’autant plus frappante lorsqu’on la met en parallèle avec d’autres priorités nationales. Le budget de la santé, pourtant crucial dans un pays où les infrastructures médicales sont sous-dotées, n’augmente que de 6,2%, atteignant 98,5 milliards en 2025, soit moins que le cumul des 112 milliards consacrés aux initiatives politiques. L’éducation bénéficie d’une hausse de 7%, passant à 152 milliards, mais cette progression reste bien inférieure aux 1215% de hausse enregistrés sur les dépenses politiques. À titre de comparaison, le budget global des investissements publics (routes, hôpitaux, écoles) est fixé à 518 milliards en 2025, ce qui signifie que plus de 20% des fonds dédiés aux projets d’intérêt général ont été absorbés par des initiatives à forte portée politique.
Gouvernance de la transition
La répartition de ces dépenses soulève également des interrogations sur la gouvernance de la transition. Les 27 milliards investis dans le référendum constitutionnel ont principalement servi à financer une campagne de communication omniprésente du “Oui”, où la figure du général Oligui Nguema était centrale. Spots télévisés, affiches géantes, meetings de sensibilisation : les dépenses pour promouvoir cette consultation populaire ont largement dépassé celles observées pour des scrutins similaires dans la sous-région.
Outre ces dépenses déjà onéreuses, la Loi de finance 2025 prévoit également 31,8 milliards de fcfa pour l’organisation d’élections. Présidentielle, locales, sénatoriales et législatives. C’est plus de 26 milliards de plus que l’exercice 2024. Mais au delà de cet aspect, c’est plus de deux fois plus que le montant alloué aux dépenses sociales qui se chiffre à 13,4 milliards de fcfa dont à peine 1,3 milliards de fcfa pour les personnes âgées et 1,1 milliard de fcfa pour la gratuité des accouchements, alors même que le pays souhaite doper sa politique nataliste.
Un budget colossal pour les dépenses politiques
Le dernier volet de ces dépenses, les 78,9 milliards budgétisés pour les dépenses politiques en 2025, s’inscrit dans la même logique. Ce montant colossal, en hausse de 1 215 % par rapport aux 6 milliards de 2024, est censé couvrir le fonctionnement des institutions de la transition, les frais administratifs et les coûts logistiques du gouvernement. Mais son ampleur soulève des doutes : dans un contexte où le président de la transition est désormais candidat à la présidentielle, cette manne budgétaire risque de se confondre avec les dépenses de campagne.
À titre de comparaison, le budget de la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP), chargée d’organiser l’élection présidentielle, est fixé à 19,8 milliards de fcfa, soit quatre fois moins que ces dépenses politiques globales. En cumulant ces 112 milliards mobilisés en 18 mois pour des initiatives politiques, une question centrale émerge : cette enveloppe budgétaire n’a-t-elle pas surtout contribué à façonner l’image d’un candidat avant l’heure ? Dans un pays où les finances publiques restent sous tension, où les besoins sociaux sont criants et où l’investissement productif est indispensable, le choix d’accorder une telle priorité aux dépenses politiques interroge sur les véritables objectifs de la transition.