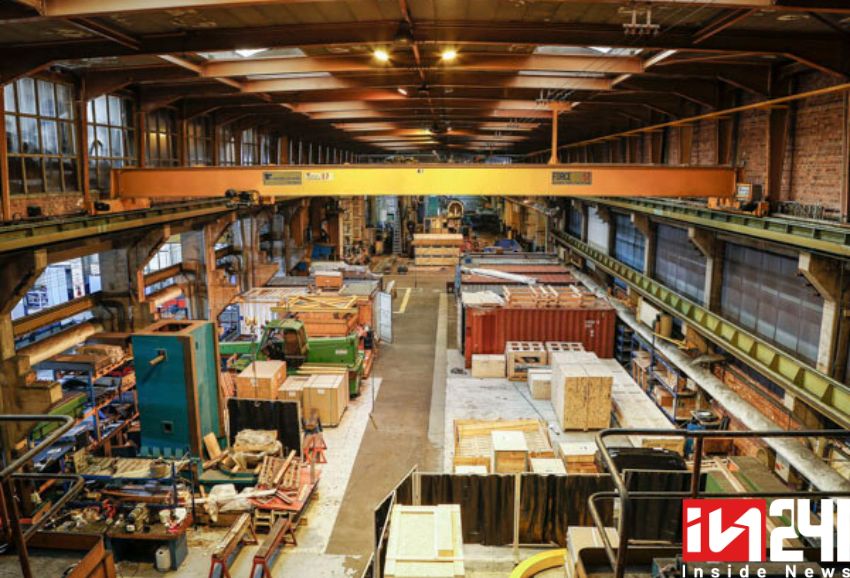La création de la Centrale d’Achat du Gabon (CEAG) a été présentée comme une mesure phare pour maîtriser les prix des produits essentiels et améliorer la souveraineté alimentaire. Mais selon l’Indice de performance logistique (LPI) de la Banque mondiale, le Gabon est classé 115e sur 139 pays en 2023, soulignant des lacunes majeures dans la gestion des douanes, des infrastructures portuaires et de la chaîne logistique. Avec un temps de séjour moyen dans les ports de 11,4 jours pour les importations, l’efficacité des achats centralisés par la CEAG pourrait être fortement compromise, remettant en cause sa capacité à garantir des prix stables et des livraisons rapides.
Les restrictions substantielles au commerce des services, révélées par l’Indice STRI, constituent un obstacle supplémentaire. Avec des scores de 66,7 pour les services professionnels, 62,4 pour les communications et 67 pour les transports, le Gabon se situe au-dessus des moyennes africaines et mondiales. En d’autres termes, la CEAG, malgré son rôle central, devra composer avec des réglementations complexes et des processus administratifs lourds, qui risquent de retarder l’acheminement des biens et de générer des coûts supplémentaires, limitant l’efficacité de la centralisation.
Un autre risque majeur réside dans la possibilité que la CEAG profite finalement au secteur privé plutôt qu’aux consommateurs. Face aux délais logistiques et aux barrières non tarifaires, les entreprises privées pourraient être favorisées via des partenariats, contrats ou externalisations pour assurer l’approvisionnement. Ce scénario pourrait transformer la CEAG en un instrument détourné, où les économies promises sur les produits essentiels profiteraient à des acteurs privés, tout en laissant le consommateur final supporter les coûts.
La dépendance à des infrastructures logistiques insuffisantes met également en lumière le paradoxe de la centralisation. La CEAG ambitionne de rationaliser le stockage et la distribution, mais sans une modernisation des ports, des routes et des systèmes douaniers, ses opérations risquent d’être inefficaces. La lenteur du passage des marchandises dans les ports et le manque de corridors logistiques performants limitent la capacité de l’État à exercer un contrôle réel sur les prix et la disponibilité des produits.
Au lieu de résoudre la problématique de la vie chère, la CEAG pourrait accentuer les inégalités entre les zones urbaines bien desservies et les provinces plus isolées. Les entreprises privées, mieux préparées pour contourner les inefficacités logistiques, pourraient capter les volumes les plus rentables, tandis que l’État se retrouverait avec des coûts supplémentaires et des responsabilités accrues. Cette dynamique met en évidence les limites structurelles de la CEAG et rappelle que centraliser les achats sans résoudre les problèmes logistiques profonds peut transformer une initiative publique ambitieuse en un simple outil de redistribution vers le privé.